L’image et ses mystères
20 octobre 2021 par Serge Toubiana - cinébloginfo
A la question « Qu’est-ce que le cinématographe ? », la réponse consiste à dire que « c’est l’écriture en mouvement au moyen de la lumière ». Cela paraît simple mais c’est une affaire hautement complexe. Le rôle du directeur de la photographie, ou de la directrice de la photographie (de plus en plus de femmes exercent aujourd’hui avec talent ce métier), consiste à éclairer le film, mais parfois également à faire le cadre. Deux fonctions qui se peuvent conjuguer en une seule, surtout dans le cinéma européen, tandis que dans le cinéma hollywoodien, les deux fonctions sont en général distinctes. Sans chef opérateur : pas de cinéma ! A ce propos, l’invention des frères Lumière consista à mettre au point une caméra avec un système entraînant le déroulement de la pellicule devant l’obturateur photographique. Louis Lumière mit au point sa première caméra en s’inspirant du mécanisme de la croix de Malte, la pellicule perforée étant entraînée dans le mouvement, permettant de projeter en public des images grand format avec un même appareil, à même d’enregistrer les prises de vues et de les projeter. Cette invention permit à de nombreux opérateurs de sillonner le monde et de rapporter des Vues Lumière, toutes splendides, conservées précieusement à l’Institut Lumière à Lyon, longtemps présidé par Bertrand Tavernier – à la suite de son décès, il vient d’être remplacé par l’actrice Irène Jacob. Et le Festival Lumière vient de s’achever, récompensant Jane Campion d’un prix hautement prestigieux. Les opérateurs ont d’emblée joué un rôle essentiel dans l’histoire alors naissante du cinéma.
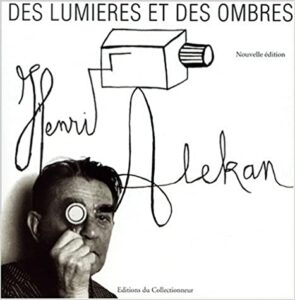
Il y a tout de même une chose assez étonnante dans le cinéma, qui est que les directeurs de la photographie ont rarement la parole. Ils s’expriment peu, ne délivrant que rarement leurs secrets. Ce sont des hommes de l’ombre, eux qui s’évertuent à capter la lumière et à jouer de ses effets. Étrange paradoxe. Il y eut évidemment le grand Henri Alekan, véritable magicien de la lumière : La Belle et la Bête de Cocteau, La Bataille du rail de René Clément, et tant d’autres grands classiques, jusqu’à sa rencontre avec Wim Wenders, d’abord sur L’État des choses (1982), puis sur Les Ailes du désir en 1987. Alekan avait fait paraître un livre somptueux en 1984, Des lumières et des ombres, aux Éditions du Collectionneur, retraçant son épopée professionnelle auprès des grands cinéastes avec lesquels il collabora.

Les Ailes du Désir (Tamasa Diffusion)
Il n’empêche que les livres de directeurs de la photographie sont rares. Est-ce parce qu’ils ou elles tiennent à garder leurs secrets, que leur talent, mélange inédit de savoir-faire manuel ou technique, se conjugue en général avec un art de s’adapter aux desiderata du réalisateur en même temps qu’aux contraintes du tournage, ne se résume pas à des formules théoriques facilement transmissibles ? Sans doute. L’an dernier, Luc Béraud avait publié un livre passionnant conçu avec Pierre Lhomme, grand directeur de la photographie, disparu en 2019, intitulé Les Lumières de Lhomme (Actes Sud/Institut Lumière). On doit à Lhomme l’image ou la lumière de plusieurs grands films, réalisés par Alain Cavalier (Le Combat dans l’île, Mise à sac, La Chamade), Jean-Pierre Melville (L’Armée des ombres), Jean-Paul Rappeneau (La Vie de château, Le Sauvage, Tout feu tout flamme, Cyrano de Bergerac), Jean Eustache (La Maman et la Putain), Robert Bresson (Quatre nuits d’un rêveur), Claude Miller (Mortelle randonnée), Bruno Nuytten (Camille Claudel), Patrice Chéreau (La Chair de l’orchidée), sans oublier sa collaboration avec Chris Marker (Le Joli Mai), etc.

Cette fois, c’est Renato Berta qui s’y colle avec un livre très agréable à lire, qui retrace son parcours de magicien de la lumière : Photogrammes, coécrit avec Jean-Marie Charuau (Grasset). Renato Berta est né en 1945 dans le Tessin, en Suisse, non loin de l’Italie. Berta commence à suivre une formation technique, à Bellinzone, sa ville natale située non loin de Locarno où se déroule chaque été, depuis 1946, un festival important. Très jeune, il s’y rend, fait la connaissance de Glauber Rocha, le jeune et fougueux cinéaste brésilien qui lui donne un conseil : « Si tu t’intéresses au cinéma, pourquoi tu ne fais pas une école de cinéma ? » A vingt ans, Renato Berta tente sa chance auprès du Centro Sperimentale di Cinematografia, à Rome, l’équivalent italien de l’ancienne IDHEC à Paris. Il réussit le concours d’entrée. Sa formation en mécanique lui aura sans doute été utile, autant que son amour du cinéma, conforté par sa rencontre à Locarno avec Freddy Buache, le Henri Langlois suisse, créateur de la Cinémathèque suisse au début des années soixante. Buache, que j’ai eu la chance de connaître, était un homme cultivé et délicieux, passionné de cinéma, l’esprit ouvert – il a écrit sur Buñuel, entre autres, était ami avec Jean-Luc Godard. La voie de Renato Berta est donc tracée. Le reste est une affaire de rencontres. Par chance, Roberto Rossellini est directeur du Centro Sperimentale, le réalisateur de Rome, Ville ouverte, de Païsa, Europe 51 et autres chefs d’œuvre du néoréalisme, ce qui est évidemment de bon augure. Berta y côtoie également Pasolini, théoricien et journaliste, poète et cinéaste qui, au cours d’une semaine passée à l’école de cinéma, analyse et dissèque devant ses élèves le film de John Ford, L’Homme qui tua Liberty Valance. Renato Berta se confronte à la question du regard ou du point de vue, essentielle dans ce film. Son apprentissage dure deux ans, Berta est diplômé de l’école de cinéma romaine, il a tout juste 21 ans. Parce que Suisse, il retourne dans son pays.
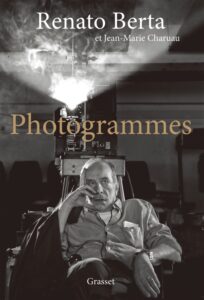
C’est alors un moment de grande effervescence en Suisse, qui voit naître ce qu’on a appelé « Le Groupe de 5 » : Alain Tanner, Michel Soutter, Claude Goretta, Jean-Louis Roy et Jean-Jacques Lagrange, tous de la même génération, ont soif de réaliser librement leurs films. Ils trouvent en la RTSR (Radio Télévision Suisse Romande) un partenaire idéal. Adeptes du 16 mm, ils commencent par réaliser des courts métrages et des documentaires, avant de passer à la fiction. C’est la naissance du cinéma helvétique, quelques années après la Nouvelle Vague française.
Renato Berta emprunte de l’argent auprès d’une banque suisse pour s’acheter une caméra 16 mm Coutant, du nom de l’inventeur travaillant pour la société Éclair. Il tourne son premier long métrage comme chef opérateur : Vive la mort de Francis Reusser. Berta et Reusser deviennent amis, nous sommes en septembre 1968. Alain Tanner rend visite sur le tournage et propose à Berta d’être le chef opérateur de son premier long métrage de fiction : Charles mort ou vif. Il enchaînera avec La Salamandre, avec Bulle Ogier et Jean-Luc Bideau. Pour ceux qui l’ignorent, La Salamandre demeura presqu’une année à l’affiche du Saint-André-des-Arts, la salle de Roger Diamantis. Devenu un film culte.

Renato Berta est demeuré fidèle aux cinéastes avec lesquels il travaille et peaufine son métier de chef opérateur. Que ce soit avec Reusser, Tanner, le couple Danièle Huillet-Jean-Marie Straub, Daniel Schmid, il fait un « bout de chemin » avec eux, passe du noir et blanc à la couleur, du 16 au 35 millimètres. De chapitre en chapitre, il évoque dans son livre sa conception de l’image cinématographique, s’adaptant à la fois au désir du réalisateur et au sujet traité par chaque film. S’il faut des convictions pour pratiquer ce métier de chef opérateur, il faut surtout une capacité d’adaptation aux contraintes imposées par le tournage : l’époque, le style, le casting, les décors, les costumes, etc. Sans oublier le budget, car faire l’image a un coût. Chaque film est une nouvelle aventure de l’image. Pour qu’il y ait une alchimie, il faut une entente parfaite entre le réalisateur et son directeur de la photographie, cela passe par des discussions approfondies avant et pendant le tournage. « C’est, je crois le collaborateur le plus proche du metteur en scène. L’organisation des plans qui composent chaque séquence passe par l’opérateur. C’est lui qui doit aussi trouver le bon équilibre entre le cadre et la photographie, qui doit gérer la dialectique entre l’un et l’autre. Autant de choses qui se font dans un dialogue permanent avec le metteur en scène. » (page 43).

On lira avec beaucoup d’intérêt les chapitres consacrés à Godard (Sauve qui peut (la vie)), André Téchiné (Rendez-vous, puis Les Innocents), Éric Rohmer (Les Nuits de la pleine lune) Louis Malle (Au revoir les enfants, puis Milou en mai), Alain Resnais (Smoking/No Smoking, puis On connaît la chanson), Christine Pascal (Adultère, mode d’emploi), Manoel de Oliveira, Amos Gitai, Claude Chabrol, Jean-Henri Roger, Robert Guédiguian, Philippe Garrel, etc. Renato Berta dessine le portrait des cinéastes avec lesquels il a travaillé, sans perdre de vue les sujets concernant l’image, les choix ou les options défendus par chacun. Son expérience couvre plus de cent-vingt films, toute une vie dédiée à l’image cinématographique. Son livre est agréable à lire parce que sincère, et qu’y affleure à chaque page son amour du cinéma.
Photogrammes, un livre de Renato Berta avec Jean-Marie Charuau, chez Grasset
Continuez votre lecture avec
- Article suivant : Le cinéma voyage
- Article précédent : Billy Wilder et moi, par Jonathan Coe
Articles similaires
Commentaires (4)
Laisser un commentaire
(Seuls les messages ayant trait au thème de ce blog seront publiés. )

Les livres des directeurs de la photo sont passionnants et fourmillent de témoignages sur les techniques du cinéma tout en faisant mieux connaissance avec ces hommes de l’ombre. Je les lis toujours avec autant d’intérêt depuis la découverte lors de mon adolescence du très beau « Un homme à la caméra » de Nestor Almendros.
Vous avez bien raison de mentionner l’ouvrage de Nestor Almendros, « L’homme à la caméra », car il fait date. J’ai eu la chance de connaître ce grand directeur de la photographie, qui travailla avec Rohmer, Truffaut, Eustache et tant d’autres.
Bonjour Serge (cette familiarité ne vous dérange pas ?)
Merci pour ce billet dédié à deux grands directeur de la photo.
Je rebondis sur l’image des Nuits de la pleine lune, que j’ai revu avec tous les Rohmer récemment en me demandant une fois de plus ce qui en fait peut-être, à mon sens, le plus beau Rohmer.
La photo, justement, moirée, nocturne ? Le look extraordinaire de Pascale Ogier ? L’étrange émotion qui surgit à la fin ? L’adéquation particulièrement affutée entre l’imaginaire rohmérien et un certain esprit des années 80 (Ogier qui dansent sur Elli & Jacno, ça me fait systématiquement crever de joie) ?
C’est peut-être cette insaisissabilité qui confère à ce film sa mystérieuse beauté.
J’apprécie votre commentaire et je pense que vous avez raison. Les Nuits de la pleine lune demeure un film inoubliable. Par ses acteurs et actrices, sa lumière, ses dialogues. Une pensée pour l’inoubliable Pascale Ogier.