Le cinéma voyage
22 novembre 2021 par Serge Toubiana - cinébloginfo
Le cinéma recommence à voyager, malgré la crise sanitaire qui perdure un peu partout dans le monde. C’est dans sa nature de voyager, les films allant d’un festival à l’autre et d’une salle à l’autre, à travers le monde, à la rencontre de nouveaux publics et de nouveaux regards.
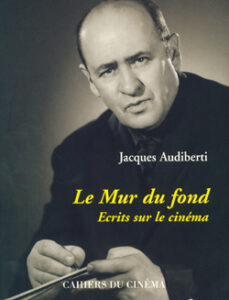
« Un film gagne beaucoup, d’avance, à être mexicain », écrivait Jacques Audiberti, ébloui par la beauté incandescente de l’actrice Ninon Sevilla. J’ai beau rechercher dans ses écrits sur le cinéma, réunis dans un ouvrage paru en 1996, Le Mur du fond, je n’ai pas retrouvé le texte dans lequel figure cet étrange axiome qui m’a toujours fait rire. J’en profite pour vous recommander la lecture de ce recueil de textes d’Audiberti, poète, dramaturge et romancier, que François Truffaut admirait énormément et qui l’inspira. Audiberti a écrit sur le cinéma pour Comoedia (dans les années 1941 à 1943), La Parisienne (de 1950 à 1953), les Cahiers du cinéma (de 1953 à 1956), Arts et la revue de la NRF (de 1957 à 1959). Il avait une manière très singulière de parler des films qu’il voyait, c’était à chaque fois une rencontre insolite, une sorte d’aventure excitante, qui l’amenait à en faire le récit souvent cocasse à ses lecteurs. Il se considérait au sens fort du terme comme un amateur de films, entrant dans chacun avec humour et légèreté, découvrant ici et là tout ce qui fait le caractère unique d’un film, qu’il soit bon ou qu’il soit un navet.

Justement le Mexique ! Je m’y suis rendu pour la première fois il y a quelques semaines à l’occasion d’un festival qui se déroule à Morelia, une très belle ville de la province de Michoacán, située à trois heures de route de Mexico City. Des amis cinéphiles et cinéastes m’avaient parlé de Morelia avec enthousiasme. Bertrand Tavernier a laissé un excellent souvenir de son passage, de même que James Ivory, Olivier Assayas et beaucoup d’autres. Cette année, l’invité d’honneur était Leos Carax, et son film Annette faisait l’ouverture du festival. Il y avait aussi une rétrospective de ses films. . Volker Schlöndorff, membre du jury, est un habitué du Mexique, depuis qu’il fut l’assistant de Louis Malle sur Viva Maria!, une grosse production tournée en 1964 au Mexique, avec Brigitte Bardot et Jeanne Moreau. Les projections officielles ont lieu au Teatro Mariano Matamoros, superbement restauré, avec une belle et grande salle pouvant accueillir plusieurs centaines de spectateurs. D’autres films français, comme Bergman Island de Mia Hansen-Løve, Titane de Julia Ducournau, L’Événement d’Audrey Diwan, étaient également programmés, preuve de la vitalité du cinéma français contemporain hors de nos frontières.

Au Cinépolis, un multiplexe de 5 salles, j’ai découvert un cinéaste mexicain dont je n’avais jamais vu aucun film : Juan Bustillo Oro (1904-1989). Il appartient pourtant au riche patrimoine cinématographique mexicain, au même titre que Emilio Fernández et Roberto Gavaldon. J’ai pu découvrir trois de ses films : Dos monjes (Deux moines) réalisé en 1934, d’inspiration gothique et très expressif sur le plan du jeu et des sentiments, El hombre sin rostro (1950, avec le célèbre Arturo de Cordoba, qui jouait le rôle principal dans le magnifique El de Luis Buñuel), et El asesino X, un thriller tourné en 1955, mais cela me suffit pour affirmer qu’il y a là un auteur à découvrir et un continent à explorer, qui fait la part belle au mélodrame et au désir sexuel contrarié. Juan Bustillo Oro a réalisé une soixantaine de films, couvrant la période d’un âge d’or du cinéma mexicain, porté par des metteurs en scène adeptes de la comédie, du mélodrame et du film policier, de grands directeurs de la photographie (Agustín Jiménez, Victor Herrera et d’autres), des actrices et acteurs considérés comme des stars dans leur pays.

Daniela Michel, directrice du festival de Morelia, présente à chaque projection de la rétrospective dont elle est à l’origine, me parle avec émotion de Pierre Rissient, venu souvent à Morelia où il a laissé une trace inoubliable, au point d’avoir son nom inscrit sur un siège de la salle 5 du Cinépolis : le premier fauteuil de la première rangée, là où il avait coutume de s’assoir pour voir des films. Cela vaut plus qu’une médaille ! Disparu le 6 mai 2018, Pierre Rissient a durant toute sa vie de cinéphile sillonné le monde tel un véritable découvreur de talents : aux Philippines (Lino Brocka), un peu partout en Asie, en Australie ou en Nouvelle-Zélande où il fut le premier à repérer les courts métrages de Jane Campion réalisés au début des années 80, avant de la convaincre de présenter Sweetie, son premier long réalisé en 1989, en compétition officielle au Festival de Cannes cette année-là.

Pierre Rissient joua également un rôle essentiel auprès de Clint Eastwood, dont il fut l’ami et le conseiller jusqu’à sa mort. C’est à lui qu’Eastwood doit en partie sa reconnaissance critique en France, qui date de la rétrospective organisée en 1986 à la Cinémathèque de Chaillot. Jusqu’alors, la critique française se montrait méfiante, pour des raisons surtout idéologiques, résumant son travail au rôle de justicier dans la peau de l’Inspecteur Harry, à peine curieuse à l’égard de ses premiers films : de Play Misty for Me à Josey Wales hors-la-loi, sans oublier Bronco Billy et Honkytonk Man. La venue d’Eastwood à Chaillot fut déterminante pour qu’il soit enfin pris au sérieux comme cinéaste. Pur hasard, Cry Macho, son dernier film, se déroule au Mexique ; il y joue le rôle d’un vieil homme taciturne, ancien champion de rodéo, personnage solitaire venu de l’Amérique profonde amené à sillonner le Mexique pour rapatrier le jeune Rafo (Eduardo Minett) auprès de son géniteur de père, et fuir ainsi les nombreux racketteurs mafieux. Avec ses valeurs anciennes d’homme blanc réactionnaire, Eastwood joue paradoxalement un rôle éminemment progressiste, comme dans la plupart de ses films : il transmet au jeune de solides valeurs humaines et lui apprend à dompter les chevaux sauvages. Ses yeux ridés se plissent, mais il continue de regarder le monde et ses turpitudes d’un œil étonné de moraliste.

A Morelia, j’ai aussi vu deux films de cinéastes reconnus internationalement, Jane Campion et Paolo Sorrentino, dont les derniers opus ont en commun d’être financés par Netflix : The Power of the Dog (Le Pouvoir du chien) et The Hand of God (E stata la mano di Dio, La Main de Dieu). Il n’entre pas dans mon rôle ici de faire la critique de ces films, mais de pointer un aspect qui me paraît nouveau et possiblement problématique : l’absence de réels producteurs dans des films d’auteurs internationaux à forte ambition. Il est probable qu’avec le développement exceptionnel d’une plateforme comme Netflix, déjà forte de ses deux cents et quelques millions d’abonnés, nous ayons dorénavant souvent affaire à des films ambitieux signés par de grands réalisateurs internationaux, en se passant pour ainsi dire de vrais producteurs à même de dialoguer avec les auteurs, de leur fixer des limites ou de faire vivre les contraintes nécessaires à l’éclosion de leur talent. Ce qu’on appelait encore récemment le travail d’un producteur, ayant la responsabilité économique du film, se transforme en celui de producteur délégué – ce qui n’est pas exactement la même chose. Ces deux films, le premier un western cosmique, magnifiquement filmé, le deuxième, une saga familiale de bout en bout passionnante et fellinienne, sont directement voués à une diffusion sur la plateforme numérique, sans passage par le grand écran. Les deux ont été remarqués lors du dernier Festival de Venise où ils étaient en compétition. La question mérite d’être posée : peut-on se passer de vrais producteurs pour entreprendre de tels films ? Je ne connais pas la réponse, me contentant de constater que la nouvelle tendance consiste pour Netflix à enrôler les grands noms du cinéma international en leur offrant carte blanche. En gros : vous avez un chèque et toute la liberté artistique, mais vous perdez le grand écran. Cela sonne-t-il le glas de la production indépendante ? Cette nouvelle tendance aura-t-elle une influence esthétique sur la nature même des œuvres cinématographiques ? Je pense pouvoir dire que oui.

Dans Libération du 9 novembre, Jean Labadie, distributeur via sa société Le Pacte (nous lui devons d’avoir découvert ces dernières semaines le magnifique Onoda d’Arthur Harari, Flag Day de Sean Penn, La Fracture de Catherine Corsini et plus récemment Tre piani de Nanni Moretti), analyse lucidement la situation du cinéma d’auteur dans les salles en cette période incertaine d’automne. Labadie pointe du doigt la responsabilité de la communication gouvernementale, accusée d’avoir « systématiquement désigné les lieux de culture – par ailleurs qualifiés à répétition de « non essentiels » – comme des zones à risque, les fermant pendant des mois puis s’en servant de secteur test pour le pass sanitaire, a été absolument catastrophique ! » L’exploitation des films cités, et plus globalement celle du cinéma d’auteur, se situe 30% en dessous des espérances du secteur, une large partie du public n’ayant pas repris le chemin des salles de cinéma. « 7 millions d’entrées en moins en juillet et août, poursuit Labadie, par rapport aux résultats pré-covid ».
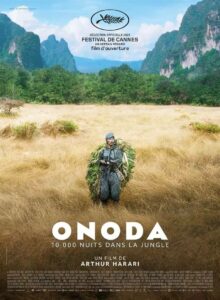
Le cinéma « commercial » s’en sort mieux. Mourir peut attendre va atteindre les 4 millions d’entrées, Dune s’en approche également, et seuls deux films français ont tiré leur épingle du jeu : Bac Nord (déjà 2,2 millions de spectateurs) et Boîte noire (près d’1,5 million, toujours en salle). Illusions perdues, le très beau film de Xavier Giannoli, adaptation de Balzac, fait une très belle carrière en salle (il pourrait atteindre le million d’entrées), Eiffel de Martin Bourboulon a passé le cap du million de spectateurs et continue son chemin. Mais plusieurs films d’auteurs découverts lors du Festival de Cannes en juillet dernier, sortis dans la foulée, mordent la poussière. Cela fait trop de peine de les mentionner, mais ils sont nombreux.
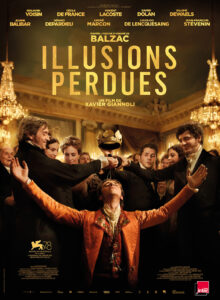
Labadie poursuit son analyse en constatant qu’un segment essentiel de la cinéphilie, le public « adulte », ne revient pas dans les salles découvrir des œuvres pourtant faites pour son goût. La cause ? « Le modèle de la consommation des films à la maison a gagné du terrain et il faut avouer que Netflix est passé maître de l’autopromotion permanente avec des moyens qui semblent illimités et un niveau de relais dans les médias que l’on est bien obligé de jalouser. » La cible est nette et précise : Netflix. Labadie aurait pu mentionner d’autres plateformes (par exemple Disney), auxquelles nombre de citoyens se sont abonnés durant les longs mois de confinement. Au-delà de l’effet conjoncturel, cette crise sanitaire qui n’en finit pas, s’estompe puis renaît de manière larvée et nous empoisonne la vie, une partie du public qui fréquentait les salles de cinéma a déserté, préférant voir films et séries à domicile. Reviendra-t-il dans les salles ? Nul ne peut l’affirmer. Ce phénomène n’est pas français mais international. Le cas de la France a ceci de particulier qu’il existe dans notre pays une vraie cinématographie, avec ses atouts indéniables : une industrie en capacité de faire fonctionner tous les rouages, de la production d’œuvres à leur exploitation en salles, de l’écriture de scripts à la réalisation, en passant par la distribution, la vente à l’étranger, la diffusion sur des chaînes de télévision, tout cela orchestré selon des règles exigeantes et précises, ce qu’on appelle par exemple « la chronologie des médias ». Tout cet édifice, patiemment mis en place depuis des décennies, envié par de nombreux pays voisins (en Europe) ou lointains (la Corée), et s’adaptant plus ou moins facilement à l’apparition de nouveaux supports liés à la révolution numérique (les plateformes), permet au cinéma français non seulement d’exister et d’exister pleinement, avec une production forte et diversifiée, travaillant sur tous les genres (fictions, animation, documentaire, etc.), mais également de coproduire avec l’étranger (Belgique, Allemagne, Italie, Espagne, etc.) et de participer au financement de nombreux films conçus hors de l’hexagone, en Afrique, en Asie et en Amérique latine, qui n’existeraient pas sans le « coup de pouce » de la France – l’aide aux cinémas du monde / CNC. Cette « stratégie française » fondée sur la diversité permet au cinéma indépendant de s’épanouir partout où c’est possible, là où domine le cinéma américain. Fin connaisseur du secteur, Jean Labadie tire une sonnette d’alarme, constatant au passage que les aides gouvernementales récentes ont surtout été attribuées aux exploitants. Ce qu’il défend, c’est la distribution indépendante, garante de cette même diversité et qui risque de devenir le maillon faible de notre industrie. Cela mérite réflexion.
Continuez votre lecture avec
- Article suivant : Joie de pouvoir bientôt redécouvrir un chef d’oeuvre de Jean Eustache
- Article précédent : L’image et ses mystères
Articles similaires
Commentaires (2)
Laisser un commentaire
(Seuls les messages ayant trait au thème de ce blog seront publiés. )

Bonjour Mr Toubiana, je ne savais pas qu’Audiberti avait écrit sur le cinéma, je vais me le procurer. Claude Nougaro lui rend hommage avec « Chanson pour le maçon ».
« Jacques Audiberti, dites-moi que faire
Pour que le maçon chante mes chansons… »
Merci pour ce joli retour de voyage au Mexique qui m’a fait découvrir Juan Bustillo Oro dont j’ignorais tout.
Sur le sujet des plateformes et de la fréquentation des salles, j’ai tendance à penser que les derniers succès, notamment celui des « Illusions perdues » qui est vraiment un très beau film, prouvent que les spectateurs ont toujours envie de se déplacer lorsque le cinéma déploie son plein pouvoir émotionnel. Peut-être que le public manifeste l’envie d’un ailleurs que beaucoup de films n’offrent pas assez… Il y a quelques temps encore les films français en costumes faisaient peur aux producteurs, mais il semble que les spectateurs ont gardé ce goût de l’Histoire. Je crois que le public a conservé intacte au fond de lui sa capacité d’émerveillement. S’il ne trouve pas un film sur une plateforme, il ira le voir au cinéma. Le déplacement comme pour un voyage, l’occasion de la sortie qu’on partage avec d’autres, restent pour l’humain des valeurs essentielles en ces temps de repli. Nombre de questions sont à se poser pour les cinéastes. Comment renouveler le récit, comment utiliser les images et le son, comment proposer quelque chose de différent pour le grand écran en terme d’espace, de temps, de rythme, sans être détourné par la lumière du jour, la mise sur pause, le téléphone qui sonne et autres tentations qui ne permettent pas de percevoir les mêmes choses sur une plateforme… Réinventer l’esprit du cinéma, retrouver l’ombre et la lumière, le sens de son expression pure comme à ses débuts. Je suis sûr que le pouvoir d’imagination des créateurs provoquera de nouvelles formes de cinéma, ils l’ont toujours fait depuis ses origines. Eisenstein ne disait-il pas en 1945 qu’un immense horizon s’ouvrait devant lui, la première partie du XXème siècle n’en ayant tiré que des miettes ?